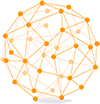Suivez le témoignage d’une ergothérapeute travaillant dans la réhabilitation psychosociale en psychiatrie. Découvrez l’importance de considérer les aspects « au-delà » du symptôme dans l’approche des patients.


PORTES OUVERTES
EN LIGNE
PORTES OUVERTES EN LIGNE
Le 6 janvier 2026
de 18h30 à 20h30
RENCONTREZ-NOUS
Venez découvrir nos parcours de formation en approche systémique stratégique, hypnose et coaching systémique. Vous rencontrerez les formateurs et pourrez échanger avec eux !
En France, dans le domaine de la santé mentale, on observe depuis les années 2000 la diffusion croissante du concept de rétablissement. Ce concept, en opposition à l’approche médico-centrée, dispose que le patient soit l’acteur principal de ses soins et propose des dispositifs qui lui permettent d'être plus autonome.
Cependant, malgré ce changement de paradigme et un travail davantage pluridisciplinaire, nous nous interrogeons sur la place occupée par le diagnostic médical et son impact dans nos pratiques actuelles. En effet, celui-ci semble toujours opérer comme un gouvernail, qui détermine et oriente les principaux axes de soins. Cela a pour conséquence que des soignants sont davantage dans l’écoute et l’observation de la partie définie comme malade chez le patient que dans la mise en valeur de ses ressources, aussi bien celles qui lui sont intrinsèques que celles issues de son environnement, et plus largement de tout ce qui pourrait faire sens dans son projet de rétablissement.
En tant qu’ergothérapeute exerçant dans un service qui propose des outils de réhabilitation psychosociale, il me semble essentiel de rappeler l’importance de ne pas négliger ce qui se situe « au-delà » du symptôme dans l’approche du patient qui nous est confié. Il n’est pas rare que je rencontre des usagers auxquels on a diagnostiqué des troubles schizophréniques et qui s’autorisent à évoquer leur vécu « traumatique » en lien avec leurs symptômes, mais aussi parfois paradoxalement avec le diagnostic posé. Il apparaît difficile pour le patient, même dans un espace dédié à cet effet, d'exprimer ses ressentis, ses expériences parfois « hors du commun » et souvent douloureuses, en n'omettant pas qu'elles puissent être à l'origine de situations de handicap.
Ce fut le cas notamment pour Charlotte, une patiente diagnostiquée de schizophrénie tardive et pour qui il semble que nous soyons passés à côté de ce qui génère véritablement un obstacle dans son quotidien. Elle s'autorise, lors d’un entretien mené selon les modalités de l’approche systémique stratégique, l’évocation de symptômes pouvant faire référence au syndrome de stress post-traumatique.
Le cas de Charlotte
Présentation de charlotte
Charlotte, âgée de 49 ans, bénéficie d'un suivi en santé mentale depuis 2018 pour syndrome confusionnel avec hallucinations acoustico-verbales sur thème mystique. Quelques mois après sa première hospitalisation, le diagnostic de schizophrénie tardive est posé. Depuis un an, elle est suivie dans un établissement public de santé mentale et bénéficie à la fois de consultations médicales et de soins dans un Centre de Ressources en Réhabilitation Psycho Sociale. Lors de l'entretien d'admission, la patiente se plaint d'être souvent angoissée et de ne pas se sentir sûre d'elle, de même en société où interagir avec autrui est difficile. Après avoir étudié la demande de Charlotte, il lui est proposé des activités thérapeutiques afin de travailler sur l'estime et l’affirmation de soi, d'exercer ses compétences relationnelles au sein d'un groupe. Le médiateur choisi par la patiente et le professionnel de santé utilise divers exercices d'expression théâtrale.
Les semaines passent et nous observons chez Charlotte des améliorations quant à la gestion de son stress. Elle prend sa place au sein du groupe et se montre efficiente dans ses compétences relationnelles Elle semble s'épanouir dans ce travail proposé, si bien que nous pensons qu'il n'y aura pas de suite à cette prise en soins qui touche à sa fin.
C'est lors du bilan de l'activité avec Charlotte que nous prenons conscience que, malgré sa satisfaction exprimée, nous n'avons pas résolu ce qui fait obstacle à son autonomie. En effet, elle exprime toujours ressentir une peur d’aller à la rencontre des autres, évoque une certaine méfiance et ne s'autorise pas à envisager un projet professionnel. La patiente craint aussi d'évoquer ses problèmes avec son médecin psychiatre, mais accepte d'en parler avec les soignants, avec qui elle dit se sentir plus en confiance. Pour donner suite à cela, nous proposons à la patiente de revenir sur son lieu de soin, afin de lui proposer un entretien qui définisse au mieux ce qui génère aujourd'hui sa situation de handicap, en utilisant l'approche systémique stratégique. Les différentes rencontres et les tâches prescrites à Charlotte sont décrites ci-dessous.
Contexte et modalités d'intervention
C'est en s'appuyant sur l'outil du schéma interactionnel proposé par l'approche systémique stratégique que nous menons cet entretien. Celui-ci oriente le questionnement du thérapeute afin de savoir auprès du patient/client comment les difficultés sont vécues selon les critères suivants : relationnel, émotionnel, cognitif, comportemental. Ce schéma permet donc d'avoir une vision globale du fonctionnement de la personne et de son problème au sein de son environnement.
La définition de son problème...
Il est important de signifier que chez Charlotte, qui se montre demandeuse de l'aide que l'on souhaite lui apporter, on ressent une gêne à se confier et peut-être aussi une difficulté à élaborer ses idées. Ses propos et ses réponses sont souvent succincts et il est nécessaire de questionner, afin de l'aider à verbaliser. De même, son expression non verbale montre de l'anxiété. Il est donc choisi de ne pas majorer les émotions négatives en exploitant uniquement ce qu'elle décide de transmettre.
Charlotte expose sa problématique actuelle. Elle raconte ne pas se sentir capable d’entrer en relation avec autrui et de ce fait, de ne pouvoir se projeter professionnellement. Charlotte se sent partagée entre ce qu'elle souhaite, comme retrouver un travail, et le discours médical qui dans ce cas précis lui propose, selon ses dires, une mise en invalidité pour mettre fin à ses angoisses. La patiente apparaît dubitative quant à cette alternative à ses projets. Charlotte dit avoir peur d'aller vers les autres et surtout « peur que cela recommence ». Elle est invitée à développer davantage ce qui fait apparaître cette émotion très dominante. Elle évoque ce qui est à l'origine de son hospitalisation en santé mentale et ce qui a justifié un diagnostic de schizophrénie tardive dans lequel elle ne se retrouve pas.
Deux ans auparavant, lors de la cérémonie funéraire de sa cousine, qu'elle a accompagnée les derniers jours précédant sa mort, la patiente a ressenti à proximité du cercueil comme « un influx » au niveau de l'avant-bras. Cette sensation (qui pourrait être traduite en santé mentale comme une hallucination cénesthésique) est interprétée par Charlotte comme un « signe » envoyé pour elle, par sa cousine.
S'enchaînent alors d'autres manifestations psycho corporelles et attitudes de bizarrerie qui amènent la famille à procéder à une hospitalisation à la demande d'un tiers. En effet, la patiente se décrit absente, voire confuse et répond difficilement aux sollicitations de ses proches très inquiets.
Sous traitement neuroleptique, la patiente se dit plus apaisée mais...elle « n'arrête pas d'y penser ». Ces sensations et ces images reviennent tous les jours et elle dit vouloir à tout prix les chasser de sa tête. Oublier devient une priorité. De même, elle souhaite éviter les lieux et les personnes que côtoyait sa cousine, ainsi que les rituels chamaniques qui selon elle peuvent être à l'origine de toutes ces perceptions.
À la rencontre de sa vision....
Charlotte est depuis longtemps attirée par les phénomènes paranormaux et les sciences occultes. Sa cousine pratiquait le chamanisme et l'invitait parfois à participer à certains rites, en jouant du tambour, ce qui provoque chez elle des sentiments contradictoires, à la fois une attirance et de l'effroi.
Au fur et à mesure que la patiente se confie, elle semble soulagée, et nous lui renvoyons cette impression. Charlotte reconnaît que jusqu'ici elle ne se sentait pas en mesure d'évoquer ses croyances, par crainte qu'elles soient mal interprétées ou incomprises par son médecin psychiatre. Si aujourd'hui Charlotte ne va pas à l'encontre des soins prescrits, elle tient à nuancer le discours médical en décrivant chez elle une fragilité et une sensibilité particulière à tous ces phénomènes inexplicables. Elle se décrit comme tiraillée entre la confiance qu'elle accorde à « celui qui sait », en l’occurrence son psychiatre, et ses croyances qu'elle dit ne pas être la seule en tant que personne, à partager et pratiquer. La patiente évoque aussi ses attirances pour les sciences occultes avec un prêtre qui se montre rassurant mais l'encourage à ne pas poursuivre ces activités qui semblent la fragiliser. Charlotte nous dit vouloir mettre en application ces conseils.
Dans cette approche constructiviste, nous pouvons citer Watzlawick (1988, p.46) qui dit « l'environnement tel que nous le percevons est notre invention ». À partir de ce postulat, notre position en tant que thérapeute sera de rejoindre Charlotte dans sa vision du monde. D'une part, parce que ce qui compte c'est la perception du patient de sa réalité, qu’elle soit considérée hors norme ou pas par notre société et parce que ce positionnement permet au thérapeute de créer cette « alliance thérapeutique » indispensable pour accompagner la personne vers un changement durable et efficace.
D'autre part, cette perception peut communiquer des informations au thérapeute sur les moyens mis en œuvre par le patient pour tenter de résoudre son problème.
Sa position
Actuellement Charlotte évite de sortir, de rencontrer des gens et d'entamer de nouveaux projets tant elle se sent fragilisée et incapable selon ses dires. De même elle s'abstient de fréquenter les lieux qui lui rappellent sa cousine, de pratiquer les rituels occultes transmis par celle-ci. Elle évite d'en parler à ses enfants et ses proches parce qu'elle ne se sent pas comprise et dit vouloir les protéger d'informations susceptibles de les inquiéter. Elle se montre actrice des soins proposés par l'hôpital, voire très demandeuse d'activités thérapeutiques supplémentaires pour, selon ses dires, gagner davantage confiance en elle.
Son émotion
Un choc « c'est comme un trauma ». Ce sont les mots de Charlotte qui revit et revoit sans cesse cette sensation vécue aux obsèques de sa cousine. Elle décrit des sensations d’angoisse mais l'objet de sa peur étant nommé, nous parlerons de la peur comme émotion principale. Lors de nos échanges, Charlotte a les yeux écarquillés et donne l’impression d’être oppressée tant l’objet de sa peur semble omniprésent.
L'exception… qui confirme la règle
Les seuls moments où la patiente ne se sent pas envahie par ces images et sensations terrifiantes sont lorsqu'elle se retrouve avec ses enfants et/ou son compagnon, ou lorsqu’elle est occupée à des tâches complexes. Il est alors plus facile de mieux comprendre le besoin souvent manifesté par Charlotte de participer à davantage d'activités thérapeutiques. En effet, derrière les objectifs initialement exprimés, on entend le souhait d’être continuellement en mouvement et d’être entourée afin de mettre à distance ses idées et ressentis douloureux.
Le système pertinent
En approche systémique stratégique, le système pertinent comprend les personnes qui peuvent être ressources auprès du patient, par opposition à celles qui contribuent, inconsciemment ou pas, à bloquer ou à faire perdurer le problème. Le seul système pertinent évoqué est sa mère, présente et à l'écoute de ses problèmes, et qui l'accompagne dans ses démarches administratives. Charlotte évite souvent les autres membres de la famille, car les réponses apportées sont souvent des conseils qui finissent, paradoxalement, par la décourager en apportant chez elle un sentiment de culpabilité. Nous pourrons nous interroger plus tard, si notre institution et ses propositions de soins, ont toujours fait partie de son système pertinent.
Sa tentative de solution
A la question de savoir « ce qui vous gêne le plus Charlotte dans votre problématique ? » La patiente répond que c'est principalement de penser sans cesse à ces images et sensations. Revivre ces souvenirs, c'est pour la patiente le risque de décompenser, en d'autres termes de retomber dans l'état qui aurait justifié une hospitalisation. Ensuite nous lui demandons ce qu'elle met en place pour y remédier, elle répond :
« J'essaie de ne pas y penser »
Selon la théorie systémique stratégique, c'est face à des situations problématiques avec une composante émotionnelle élevée que l'on peut mettre en évidence la tentative de solution de la personne. Il y a trois grandes catégories de tentatives de solution : la fuite, le contrôle et l'interprétation de la situation, selon une « croyance » que l'on cherche à confirmer (Nardone, 2016).
Dans le cas de Charlotte, elle tente en premier d'éviter, donc de fuir ses pensées, ses ressentis par peur de tomber à nouveau dans la « folie ».
« C'est moins le problème lui-même que les efforts tentés pour le résoudre qui le perpétuent et l'exacerbent par inadvertance. » (Watzlawick, 2010, p.220).
La tentative de solution, comme une causalité circulaire, qui maintient voire aggrave une situation problématique. Plus Charlotte évite de penser à ces images provoquant des sensations douloureuses et surtout effrayantes, plus celles-ci s’amplifient en majorant des émotions négatives faisant paradoxalement apparaître l’objet non désiré.
Première tâche prescrite
L'exercice du pire
L’exercice choisi est orienté sur le problème du patient et consiste à imaginer le pire de façon consciente, et ce dans un cadre posé à l'avance par l’intervenant. Charlotte doit privilégier un temps d'une demi-heure dans sa journée et se mettre si possible au calme. Elle doit imaginer tout ce qu'elle craint, ce qui lui fait peur jusqu'à le ressentir physiquement. De préférence, elle programme un réveil qui sonne le début et la fin de la tâche. Une fois celle-ci terminée, elle se passe de l'eau fraîche sur le visage et retourne à ses préoccupations quotidiennes. En ce qui concerne Charlotte, il s’agira de convoquer pendant une demi-heure ses sensations, ses ressentis douloureux survenus lors des obsèques de sa cousine.
Cet exercice illustre qu'il est possible de faire disparaître un symptôme en l'évoquant volontairement. Il s’agit de se confronter à ses craintes, ses peurs pour les affaiblir, les supprimer. Cette tâche peut aussi être mise en image avec le stratagème chinois « Étouffer le feu en ajoutant davantage de bois » (Nardone, 2008, p.49).
Retour de la mise en application de la tâche
La patiente apparaît détendue et souriante. Nous échangeons sur la satisfaction de nous voir réciproquement. En effet, après avoir prescrit cette tâche avec laquelle je me sentais en confiance à l'instant t avec la patiente, je me suis ensuite inquiétée de la possibilité qu’elle mette Charlotte en difficulté et génère de l'angoisse chez une personne diagnostiquée psychotique et pour qui le stress peut majorer des recrudescences délirantes et/ou hallucinatoires.
Th : Alors dites-moi comment s'est déroulée votre tâche ?
Patiente : Oh là là ce n’était pas facile hein... (rire) mais je l'ai fait ! (Fierté)
Th : Oui j'imagine que ce n'était pas simple ce que je vous ai demandé comme exercice. L'avez-vous fait tous les jours ou bien ?
Patiente : Oui tous les jours mais parfois je l'ai fait par écrit...
Th : Et alors... ?
Patiente : Et bien difficile sur le moment mais après ça, c'était moins intense.
Th : Quoi donc ?
Patiente : Les idées auxquelles je pense... D'ailleurs j'ai un autre problème à vous soumettre.
L'idée ici n'est pas de retranscrire toute la rencontre mais de s'arrêter sur ce qui, pour moi, à « fonctionné » et de mettre en réflexion les différentes pistes potentielles que j’aurais pu suivre. Charlotte évoque un apaisement et propose tout de suite de passer à un problème qui lui paraît prioritaire. Je suis la première surprise par cette réaction car, selon moi, ce travail prendrait davantage de temps. Et surtout, je constate que les exercices n'ont pas majoré l'angoisse de la patiente. La supervision collective me permet de comprendre que pour une première tâche, celle du « roman du trauma » aurait peut-être été préférable. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque Charlotte transforme l'exercice par écrit, elle s'approprie le soin en l'adaptant d'elle-même à ses capacités.
Cependant, il m'est encore difficile de savoir, à ce moment-là, si c'est la mise en évidence d’un problème qui s'atténue, et qui permet de laisser place à l’énonciation d'un autre problème, apprécié comme plus important par Charlotte, ou s’il s’agit d’une éventuelle désorganisation de la pensée qui fait obstacle à la hiérarchisation et à la priorisation des idées, comme on peut l'observer dans les troubles psychotiques. En revanche, j'ai l'assurance que la patiente me fait confiance et voit un intérêt à poursuivre.
Deuxième problème, nouvelle tâche
Présentation du problème
Charlotte évoque cette fois-ci un stage sur l'estime de soi proposé par Pôle emploi et qui se déroulera très prochainement. Elle craint de s'y rendre car s'imagine que les autres vont savoir « qu'elle est malade » et « qu'elle ne sait plus rien faire ». Une problématique souvent observée chez les personnes avec des troubles psychiques : cette intime conviction que « les autres » savent de quoi vous souffrez. Cette perception erronée limite beaucoup leurs interactions sociales. En dehors d'une appréhension que l'on pourrait qualifier de normale, vu ce contexte où elle intègre un groupe de personnes qu'elle ne connaît pas, on observe à nouveau un stress important où toutes ses compétences sont remises en cause et où la réassurance n'est d'aucune utilité. Quant à son compagnon, il l'encourage à « se bouger » et à retrouver un emploi. Cette attitude, bien que bienveillante, n'autorise pas Charlotte à lui en parler davantage car elle a pour effet de créer chez elle un sentiment de culpabilité.
À ce problème, Charlotte décrit à nouveau une tentative de solution de l'ordre de l’évitement qui consiste à vouloir à tout prix penser à autre chose.
Seconde tâche prescrite « la liste des prévisions négatives »
Dans cet exercice, il est demandé à la personne de dresser quotidiennement la liste de ce qu’elle redoute le plus. Mettre par écrit toutes ses anticipations anxieuses que ce soient ses idées, ses ressentis, ce que l'on pourrait lui dire ou pas, lui faire ou pas et qui la placerait dans une position très inconfortable.
Charlotte doit acheter un cahier où elle réalisera l’exercice détaillé ci-dessus ; avant et pendant sa période de stage et ce tous les matins jusqu'à notre prochaine rencontre. Cet exercice s’ajoute à la première tâche afin de consolider les acquis de la patiente. Objectif de cette tâche : mettre hors d'elle ses pensées envahissantes et mettre à distance ses anticipations anxieuses afin de profiter au mieux de son stage et des expériences positives correctrices que celui-ci pourrait lui apporter.
Retour de la mise en application de la tâche par Charlotte
Charlotte apparaît souriante et semble avoir « survécu » à ce stage. Elle décrit ses craintes et appréhensions mais également ses réussites. Je demande à Charlotte ce qu'il en est de ses tâches. Elle évoque en premier la deuxième tâche qu'elle a finalement peu réalisée : trois fois sur 15 jours. Elle me dit que parfois elle n'a pas eu le temps ou pas trouvé nécessaire de réaliser l'exercice.
TH : Et pour la première tâche ?
Charlotte : Non je n'ai pas eu besoin de la faire
Th : Ah bon pourquoi ?
Charlotte : Je n'ai plus ces idées-là en tête.
Th : C'est une bonne nouvelle ?
Charlotte : Heu oui. (Surprise)
La mise en évidence de cette réussite était selon moi importante car ici la patiente est enfermée dans cette perception d'échec en permanence et semble surprise de ses progrès. Certains patients avec des troubles psychiques ont de telles difficultés d'analyse et d’introspection, rencontrent tant d'obstacles les mettant en situations d'échec, qu'il peut leur être difficile d'apprécier ne fusse que des petites victoires. Toute démarche de formation ou même, ce qui sera son futur projet (d’entrer dans une agence d'intérim), semble soucier la patiente à cause de mêmes tentatives de solution. Il est proposé à la patiente de poursuivre cet exercice qui a fait ses preuves et de revenir vers moi uniquement si elle en ressent le besoin. Charlotte se montre très demandeuse d’étayage ces dernières années en santé mentale. Je souhaite par cette action placer Charlotte dans une position nouvelle où c’est elle qui évalue, qui expérimente ce qui fonctionne ou non, lui permettant ainsi un petit pas vers la reprise de « pouvoir » sur elle et son histoire.
Des opportunités nouvelles dans le rétablissement des patients
L'approche systémique stratégique et ma rencontre avec Charlotte m'ont fait prendre conscience, d’une part, de l'importance du premier contact et du temps nécessaire et indispensable pour accueillir la problématique de la personne dans sa globalité, comme le défend le concept de rétablissement en santé mentale.
« Pour un résultat rapide il faut prendre son temps »
D'autre part, l’approche systémique stratégique m’a fait prendre conscience de l’intérêt accordé à la vision du monde du patient. Charlotte, comme beaucoup de patients rencontrés, arrive dans nos services avec un diagnostic posé. Pour elle, il représente un obstacle car il va à l'encontre de sa vision. Il apparait donc indispensable de porter une attention toute particulière à la façon dont celui-ci peut être accueilli par le patient et de s’intéresser aux obstacles qu’il peut engendrer, que ce soit dans son quotidien mais aussi dans sa capacité à envisager de futurs projets.
Charlotte se prive pendant de longs mois d'évoquer ses émotions et les pensées qui y sont associées, de peur de ne pas être en accord avec l'avis du corps médical. La patiente l’explique par toutes ses projections, plausibles ou pas, notamment sur des décisions qui pourraient être prises à son égard, que ce soit un changement de traitement ou pire, de devoir retourner sur le lieu d'hospitalisation. Cela évoque pour elle la période de sa vie où tout a basculé.
Si un diagnostic de schizophrénie tardive est posé, le discours de la patiente lors de mes entretiens renvoie quant à lui des symptômes qui s'apparentent à ceux du syndrome de stress post-traumatique. Ils sont en lien avec le vécu de symptômes impressionnants et de leurs répercussions sur elle mais aussi sur la vie de ses proches. Loin de moi l'idée de vouloir affirmer un diagnostic différent, ce qui n’entre pas dans mon champ de compétence, mais d'attirer à nouveau l'attention sur ce qui nous préoccupe et sur ce qui doit être pris en compte si l'on souhaite travailler en collaboration avec le patient, c'est-à-dire sa vision et son vécu, qu'ils soient réalistes ou non.
Lors des entretiens, Charlotte s'approprie les tâches prescrites sans que cela majore sa peur. Cependant, je réalise que mes références médicales, celles qui permettent d’élaborer un diagnostic, me font parfois douter de la véracité et/ou de la pertinence des propos recueillis auprès de la patiente ainsi que du choix de mes actions. Si l'OMS définit la santé comme un état de bien-être général physique et psychique ne dépendant pas uniquement d’une absence de pathologie, je m'interroge sur la possible influence négative que peut avoir encore aujourd'hui le diagnostic sur le patient autant que sur la pratique des professionnels de santé.
Dans mon travail, malgré les visions plus humanistes qu'offre le nouveau paradigme du rétablissement, j'observe que le socle sur lequel nous nous appuyons, nous les soignants dans le milieu psychiatrique, reste le diagnostic médical. Celui-ci agit comme s'il prédestinait les grands axes de soins, ce qui me fait penser à la théorie de Golem de Jacobson et Rosenthal en opposition à l'effet Pygmalion qui consiste à conditionner un individu avec des attentes négatives provoquant une diminution de l’estime de soi, de son sentiment d’efficacité personnelle et de sa performance. Dans ce cas-ci, les professionnels de santé peuvent inconsciemment, avec des attentes négatives ou sous estimées des potentiels ou du devenir du patient, conditionner celui-ci de telle façon qu'il perde confiance en lui et voir alors ses capacités diminuées. Les soignants, sous l'influence d'une doctrine classificatrice, peuvent influencer à leur tour les propositions et les modalités de soins, pas toujours en accord avec les attentes et les besoins réels de la personne. Nous pouvons constater que nous répondons bien plus souvent aux attentes institutionnelles en proposant des solutions aux patients en fonction de ce que nous avons à notre disposition, que ce soient des outils ou des savoir-faire spécifiques.
Le patient doit normalement être informé de ce pourquoi il consulte. Ce qui peut sembler une évidence, un droit. Contrairement au cas de Charlotte, nommer ses troubles peut parfois produire du soulagement pour l’intéressé et ses proches. Certains patients prétendent que le fait d'entendre un diagnostic leur permet de mieux comprendre et de mieux savoir où ils vont. Leurs propos m'interpellent. Car comment un diagnostic défini par une classification mondiale, principalement le DSM, peut déterminer à lui tout seul l'orientation de toute une vie, en omettant les particularités individuelles et l'influence du contexte, notions privilégiées par les approches systémiques.
« L'être humain n'a rien de définitif...Il ne connaît que l'inachevé. » (Corcos, 2015, p.203)
Se former à la thérapie brève systémique et stratégique
LACT propose plusieurs parcours de formation web certifiantes en direct avec 50 formateurs internationaux :
- Formation systémique généraliste
- DU clinique de la relation avec l‘université de Paris 8
- Mastere clinique de Giorgio Nardone LACT/CTS
LACT, vous accompagner dans les parcours de reconversion
Les formations LACT sont particulièrement adaptées aux situations de reconversion avec des enseignements 100% à distance, et un suivi vers l’installation professionnelle.
Pour connaître les tarifs, sélectionnez la formation qui vous intéresse
CARTOGRAPHIE DES TOUS LES PARCOURS DE FORMATION LACT
APPROCHE SYSTémique
et stratégique
Pré-
requis
général
Bac
avec ou sans
expérience
clinique
clinique
Bac +3
avec
expérience
clinique
Bac +5
avec
pratique
clinique
éducation
Bac +3
avec
expérience de
l’enseignement
ENTREPRISE
Bac
avec ou sans
expérience de
coaching
Bac
avec ou sans
expérience de
coaching

CERTIFICAT
LACT
-
NIVEAU
FONDEMENTS
DIPLÔME
D'UNIVERSITÉ
-
CLINIQUE
DE LA
RELATION ET
INTERVENTION
STRATÉGIQUE
-
avec
Université Paris 8
DIPLÔME
-
MASTÈRE
CLINIQUE ®
EN THÉRAPIE
SYSTÉMIQUE
STRATÉGIQUE
DIPLÔME
D'UNIVERSITÉ
-
APPROCHE
SYSTÉMIQUE
STRATÉGIQUE
DE
L’ÉDUCATION
-
avec
Université Paris 8

CERTIFICAT
ACCOMPAGNER
LE CHANGEMENT
-
NIVEAU
FONDEMENTS
COACHING
SYSTÉMIQUE
VIA CERTIFICAT ISC
CERTIFICAT
LACT
-
NIVEAU
FONDEMENTS
COACHING
SYTÉMIQUE

CERTIFICAT LACT - NIVEAU PRATIQUE
DIPLÔME
COACH
SYSTÉMIQUE ®

DIPLÔME SYSTÉMICIEN ® - CLINICIEN DE LA RELATION ® - NIVEAU PERFECTIONNEMENT
DIPLÔMES
MASTÈRE CLINIQUE® EN THÉRAPIE SYSTÉMIQUE STRATÉGIQUE ![]()
MASTÈRE HYPNOSE
APPROCHE SYSTémique
et stratégique

général
Bac
avec ou sans
expérience
clinique
clinique
Bac +3
avec
expérience
clinique
Bac +5
avec
pratique
clinique
CERTIFICAT
LACT
-
NIVEAU
FONDEMENTS
DIPLÔME
D'UNIVERSITÉ
CLINIQUE
DE LA
RELATION ET
INTERVENTION
STRATÉGIQUE
avec Université Paris 8
DIPLÔME
MASTÈRE
CLINIQUE ®
EN THÉRAPIE
SYSTÉMIQUE
STRATÉGIQUE
ENTREPRISE
Bac
avec ou sans
expérience de
coaching
Bac
avec ou sans
expérience de
coaching
éducation
Bac +3
avec
expérience de
l’enseignement
CERTIFICAT
LACT
-
NIVEAU
FONDEMENTS
COACHING
SYTÉMIQUE

CERTIFICAT
ACCOMPAGNER
LE CHANGEMENT
-
NIVEAU
FONDEMENTS
COACHING
SYSTÉMIQUE
VIA CERTIFICAT ISC
DIPLÔME
D'UNIVERSITÉ
-
APPROCHE
SYSTÉMIQUE
STRATÉGIQUE
DE
L’ÉDUCATION
avec Université Paris 8

CERTIFICAT LACT
NIVEAU PRATIQUE
DIPLÔME
COACH SYSTÉMIQUE ®

DIPLÔME SYSTÉMICIEN ® - CLINICIEN DE LA RELATION ® - NIVEAU PERFECTIONNEMENT

DIPLÔMES
MASTÈRE CLINIQUE® EN THÉRAPIE SYSTÉMIQUE STRATÉGIQUE ![]()
MASTÈRE HYPNOSE
Ressources sur l’approche systémique dans la pratique en psychiatrie
- Chapitre 1. Qu’est-ce que l’approche systémique ? - Cairn.info (https://www.cairn.info)
- L'approche systémique en santé mentale - Directory of Open Access Books (https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/41121)
- L’approche systémique en psychiatrie de liaison à l’hôpital général - ScienceDirect (https://www.sciencedirect.com)
- L’épigénétique comme partenaire de la psychiatrie - ScienceDirect (https://www.sciencedirect.com)
- L’approche systémique en santé mentale - Psycha Analyse (https://www.psychaanalyse.com)
- Les fondements des psychothérapies - Dunod (https://www.dunod.com)
- Approche systémique et relation d’accompagnement - Actif Online (https://www.actif-online.com)
- Aide-Mémoire - Le soin en psychiatrie - Les fondamentaux - Dunod (https://www.dunod.com)
- De la pratique traditionnelle à la pratique contemporaine de la psychoéducation Érudit (https://www.erudit.org)
- L'Éducateur et l'approche systémique: manuel pour améliorer la pratique - UNESCO (https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000137882)
- Pour une vision systémique de la psychiatrie de liaison - ScienceDirect (https://www.sciencedirect.com)
- Centre d'études et d'interventions systémiques de méthodologie et d'épistémologie du soin - CEISME (https://www.ceisme.org)
- Les infirmiers de pratique avancée français, de la vision à la mise en pratique - ScienceDirect (https://www.sciencedirect.com)
- L'approche systémique en santé mentale (N.E.) - Amazon.ca (https://www.amazon.ca)
- Approche systémique de la gestion des ressources humaines - Academia.edu (https://www.academia.edu)
- L’approche systémique en dix étapes - World Health Organization (https://apps.who.int)
- Approche systémique en psychiatrie de consultation-liaison - ScienceDirect (https://www.sciencedirect.com)
- Thérapie systémique et psychiatrie - Centre de Psychothérapie (https://www.centredepsychotherapie.fr)
- Approche systémique en psychiatrie : concepts et pratiques - Cairn.info (https://www.cairn.info)
- Les théories systémiques en psychiatrie - Revue de Psychiatrie (https://www.revue-psychiatrie.fr)
- Applications cliniques de l’approche systémique en psychiatrie - Psychomedia (https://www.psychomedia.qc.ca)
- L’impact de l’approche systémique sur les soins psychiatriques - Santé Mentale (https://www.santementale.fr)
- Répondre aux défis psychiatriques avec l’approche systémique - Journal de Psychologie (https://www.journaldepsychologie.fr)
- La psychiatrie systémique en pratique - Santé Magazine (https://www.santemagazine.fr)
- Approches intégratives en psychiatrie systémique - Association Française de Thérapie (https://www.aft-therapie.fr)
- Formation en thérapie systémique pour les psychiatres - Académie de Thérapie (https://www.academiedetherapie.fr)
- Interventions systémiques en psychiatrie - Portail de la Santé (https://www.portaildelasante.fr)
- L’approche systémique et les soins psychiatriques contemporains - Centre de Psychiatrie (https://www.centredpsychiatrie.fr)
- Les fondements de la psychiatrie systémique - Presses Universitaires (https://www.presses-universitaires.fr)
- Évaluation de l’approche systémique en psychiatrie - ScienceDirect (https://www.sciencedirect.com)